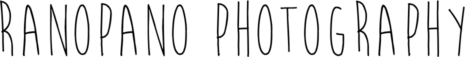Lumière sur le sépulcre
Il y a si longtemps que je vis ici. Enfin, vivre, c’est un bien grand mot ; survivre serait un terme plus approprié. C’est étrange, comme certaines choses vous arrivent. C’est étrange, la vitesse de la vie, la vitesse à laquelle on peut se résigner, et puis changer et puis vieillir. L’autre jour, dans le réduit qui me sert de salle de bains, j’ai observé mon reflet déchiqueté dans les restes d’un miroir détruit. J’ai considéré sans indulgence ce visage gris, veuf de toute lumière, tavelé par l’indifférence et la solitude. Ce visage, c’est le mien à présent et peu de gens ont l’occasion de le voir.
Une fois par semaine, parfois deux, je sors la vieille Raleigh de la remise à demi effondrée où j’ai pris l’habitude de la dissimuler et je roule jusqu’au village de D. Il n’y a que cinq ou six kilomètres. Le rituel est toujours le même : d’abord le bureau de poste, puis l’épicerie. Je touche mon mandat hebdomadaire et ensuite je m’achète de quoi me nourrir. Je n’échange que les paroles strictement nécessaires avec ceux que je rencontre en ces circonstances. Ce sont les seuls moments où j’entends le son de ma propre voix, cette voix devenue basse, méconnaissable, comme assourdie par les longues plages de silence qui constituent mon seul paysage.
Quand les derniers moines sont partis, en février 1969, ils m’ont expliqué ce qu’ils attendaient de moi : que je veille sur la crypte où reposaient tant des leurs. Ils me faisaient confiance. Ils me connaissaient bien. C’est moi qui ai procédé à l’ensevelissement de plusieurs d’entre eux. J’utilise le mot ensevelissement car je n’en ai pas trouvé d’autre, mais au vrai ici personne n’est enseveli : c’est plutôt comme une très longue morgue dont les tiroirs seraient clos à tout jamais. Il m’arrive, surtout la nuit, de marcher de long en large le long des plaques funéraires sur lesquelles la plupart des inscriptions sont devenues illisibles. Leurs noms n’existent plus que dans ma mémoire et, quand je mourrai à mon tour, ils disparaîtront avec moi.

Il y a si longtemps que je suis seul. Je crois que je ne pourrais plus supporter de partager quoi que ce soit avec quelqu’un d’autre. Mes compagnons de voyage me conviennent, ils sont discrets et silencieux. Cependant parfois on vient interrompre ma quiétude. Des inconnus s’approchent, rôdent autour de la crypte, finissent par en découvrir l’accès et viennent s’y promener. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne vois pas quel intérêt ils peuvent bien trouver à cet endroit enkysté dans la mort, oublié de tous. Et je ne veux pas qu’ils me voient, qu’ils me parlent, qu’ils révèlent ma réclusion, ma semi-existence, le destin immobile que je me suis lentement forgé, depuis quarante ans que j’habite mon propre tombeau. Alors je me cache. Je me dissimule au milieu des morts. Ce n’est pas bien difficile pour quelqu’un qui, tout bien considéré, n’est qu’à peine vivant. Je les observe et eux ne me voient pas. Ils prennent des photographies, parlent à voix basse, parfois dans des langues que je ne comprends pas. Puis ils repartent et je retrouve ce que, dans le seul exercice d’ironie que je m’autorise encore, je nomme liberté.
Bien sûr, je pourrais partir. Ou plutôt, j’aurais pu le faire, bien des années auparavant. Personne n’est jamais venu vérifier si je méritais bien l’argent que l’on continue de me faire parvenir, chaque semaine, par le truchement de mandats antédiluviens. Mais il est bien trop tard à présent. Je fais partie de ce lieu, au même titre que les tiroirs emplis d’ossements et de poussière, que les traces verdâtres que l’humidité a laissées sur les murs, que les pauvres meubles qui m’environnent. Je vais rester ici et, lorsque je sentirai la fin approcher, avant que d’être trop engourdi, j’irai me blottir dans l’un des derniers tiroirs encore vides. Il n’y aura alors plus personne pour se souvenir, plus personne pour savoir ce qu’a été ma vie, ma vie ici, et plus personne pour regarder les explorateurs tandis qu’ils se laissent, les uns après les autres, fasciner par tout ce que l’abandon, le malheur et la décrépitude peuvent charrier de poésie.
Texte par Nicolas Fourny
Musique par Nosfell