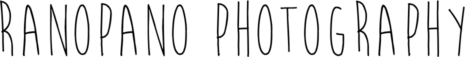Trois murs pour la salle de torture
Il n’y a plus de bientôt. Il n’y a plus de peut-être. Le désir est mort en moi. Ils pourraient ouvrir les fenêtres, cesser de me surveiller, ça ne changerait rien, je n’essaierais même pas de m’enfuir. La fuite a longtemps ressemblé à un vieux rêve flou. Je n’ai pas réussi à lui donner ce qu’il aurait fallu de netteté pour qu’elle rejoigne le réel ; mon réel. Mon ici. Le territoire qu’il me reste et qu’on a fait semblant de me donner, pour me donner un peu de répit entre deux séances. C’est comme ça qu’ils disent : des séances. C’est un terme affreusement neutre et vide, on peut le remplir de tout ce qu’on veut, des voix doucereuses, des cris, de la sueur, des supplications vaines.
Je sais qu’il fait jour, je parviens encore à distinguer la différence de luminosité avec la nuit, à détecter l’aube et le crépuscule. Mes lunettes ont disparu il y a des mois, peut-être des années de cela. Et ensuite ils se sont occupés de mes yeux. J’ai oublié ce qu’ils leur ont fait. Il ne me reste que la mémoire atrophiée des êtres et des choses qui étaient là avant. Avant cette pièce tout emplie de contusions, avant la peur, avant que je ne comprenne que ma vie s’était arrêtée à la minute où je suis entré ici pour la première fois.
J’ai réussi à élaborer une forme de consolation. Mon âme n’est plus ici, elle n’est plus retenue à mon corps que par les fils décharnés de la raison, qui menacent de rompre à tout instant. Nous allons vous amener au bord de la folie. Cette phrase émerge avec entêtement au milieu des souvenirs en train de sombrer. Qui l’a prononcée ? Un des types en noir qui entrent ici de temps à autre et m’emmènent ailleurs ? Ces mots, énoncés sans heurt, sans haine, sans émotion, comme quelqu’un qui annoncerait l’heure du départ d’un train.
Je ne peux plus m’asseoir sur cette chaise. Je reste allongé sur le sol froid et sale, là où ils me jettent quand ils me ramènent dans ma geôle. Depuis un certain temps, ils sont obligés de me porter. Mes jambes pendent, inertes. Elles ne me renvoient plus aucune sensation ; au bout d’un moment ils l’ont compris et ont cessé de les meurtrir pour se consacrer à d’autres parties de mon corps. Au début, par une fierté dérisoire, je crois que j’essayais de retarder le plus possible l’instant du premier cri. Je haletais longuement sous les coups, les décharges électriques, les désarticulations. Mais la fierté, comme la volonté, le ressentiment, et même le dégoût, finit toujours par refluer et disparaître. A la place, viennent se greffer un ignoble soulagement quand tout s’arrête, quand ils sont fatigués de me faire mal, et une gratitude malsaine quand ils me nourrissent.

Ce corps qu’ils tourmentent, jour après jour, n’est plus le mien. Je le leur laisse. Qu’ils le prennent. Qu’ils le piétinent. Qu’ils le consument. Il ne contient plus rien, à part une mécanique à bout de forces dont le sort a cessé de m’importer. Quand je suis seul, je m’en vais. Je m’en vais très loin, là où ils ne pourront jamais m’atteindre, en un lieu qu’ils ne pourraient pas comprendre ni aimer. La douceur s’est muée en un songe amer, mais cette amertume est la clé de ma survie. Elle m’attend au seuil d’un monde dont je connais les secrets, car c’est moi qui l’ai rêvé. Elle me prend par la main, sans un mot, sans sourire. Elle m’entraîne loin des regrets, loin des regards morts de ceux que j’ai trahis.
Là, je n’ai plus besoin d’être pardonné, la souffrance est dépourvue de sens, il n’y a plus de portes à ouvrir sur des couloirs dédiés à la terreur, plus de blessures en train de pourrir, plus de poings qui se referment pour frapper. C’est là, loin des murs vert pâle, loin du soleil inutile et des espoirs trompeurs, que j’ai compris que j’étais mort. Quand ils me manipulent à présent, je pourrais aussi bien être un tas de chiffons, ou le cadavre mou d’un noyé de quinze jours.
D’où je gis, je discerne l’ombre de la chaise en train de s’allonger sur le sol. Dans les films, les prisonniers se basent souvent sur ce genre de détails pour estimer l’heure qu’il peut être. Pas moi. Je me contente d’imaginer la poussière qui tombe lourdement, à son rythme, dans les rais de lumière. A une époque de ma vie, j’aimais m’attarder sur la beauté précise de ces moments-là.
Un jour, ils feront le geste de trop, donneront le coup de trop, et ce sera terminé. Je me suis habitué à espérer que ça se produise. C’est comme si je voulais télécommander mon propre suicide. Il aurait fallu saisir le moment décisif où la mort a cessé d’être une menace pour se transformer en libération. Cela aussi, je l’ai oublié. Je ne suis plus que ce que je suis devenu : un demi-être, calciné de l’intérieur, souillé au-delà de l’imaginable, déjà parti pour l’essentiel, déjà absenté de ce monde qui accepte, ferme les yeux, consent, ou s’en moque.
Ils ne vont plus tarder à venir.
Texte par Nicolas Fourny
Automne Secret
Musique par Daïtro