Devant Nous, Rien
Je vais ouvrir cette porte.
Je vais ouvrir cette porte comme on ouvre les yeux après un trop long sommeil.
Il y a longtemps que j’en ai envie, que je pense à ce qui doit se trouver derrière. Que vaut l’imaginaire d’un type comme moi ? Vous devez croire qu’il a été tué, rongé à petit feu, aliéné par tout le temps que j’ai perdu ici. Parce que, oui, ici, j’ai perdu mon temps. C’est une expression dont la banalité n’est qu’apparente ; en réalité, ces quatre mots sont terrifiants. Ils désignent le plus affreux gâchis dont un être humain peut se rendre coupable : laisser s’en aller les jours, puis les années, et enfin sa propre existence, sans rien en faire, sans laisser de trace, comme on laisserait partir une barque vide au gré des remous et des courants d’un fleuve indifférent.
Je n’ai pas compris tout de suite ce qui m’arrivait. Dans le bruit ininterrompu des machines, vous ne pouvez vous offrir le luxe de penser, ni même de réfléchir. Le geste est mécanique, machinal, presque hypnotique. Pendant que vous travaillez, sous la lumière grise, sous les yeux éteints des contremaîtres, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de mourir. Vous êtes seul avec l’outil, la perpétuelle contrainte, le métal épousant pour de brèves secondes un autre métal, qui s’enfuit tout de suite, s’en va poursuivre son voyage, et immédiatement une autre pièce se présente, vous vous penchez sur elle, et ainsi de suite du matin jusqu’au soir, comment voulez-vous parvenir, dans ces conditions, à vous interroger sérieusement sur quoi que ce soit ?
Vous êtes seul. D’autres hommes sont à proximité de vous, occupés à faire la même chose que vous, dans des conditions identiques, cependant c’est une proximité illusoire car au vrai ils sont tout aussi seuls que vous l’êtes, et eux aussi meurent tout doucement, comme vous le faites, sans s’en rendre compte. Le bruit vous isole, le temps vous est compté, le chronomètre tourne, mesure la vitesse et la régularité de votre effort. Il faut aller vite. Il faut bien faire. A quoi donnons-nous vie ? Nous ne sommes pas des créateurs. L’objet que nous façonnons ne sera jamais notre enfant. Nos postures ont été décidées ailleurs, dans les bureaux brillamment éclairés des ingénieurs, qui scintillent au loin, quatre étages au-dessus de nous, à l’écart du tintamarre, des heurts, du sol graisseux, des voix rudes, de la liberté désapprise.
J’ai été seul. J’ai écouté, le matin, la grande rumeur inhumaine commencer de murmurer puis de s’épanouir en un concert guttural qui ne s’éteignait que le soir. Quand elle s’arrêtait, une brève plage de silence la remplaçait, pendant laquelle on n’entendait nulle voix ni nul autre bruit, comme si les êtres hésitaient à reprendre la parole, prenaient le temps de recalibrer leurs phrases après avoir dû hurler des heures durant pour se faire entendre. Le plus souvent, je ne partais pas tout de suite. Quelques minutes durant, je regardais la porte, sa peinture ternie, son verre dépoli qui masquait un horizon dont l’énigme me ravageait. Un millier de fois j’ai songé à franchir la cinquantaine de mètres qui nous séparaient, à saisir la poignée, à la pousser enfin ; j’y ai songé mais je ne l’ai pas fait, et d’ailleurs, en y réfléchissant à présent, je m’aperçois que, durant toutes ces années, je n’ai jamais vu personne franchir cette porte, ni pour entrer, ni pour sortir, jamais.

En arpentant la route qui me menait à la ville, le soir, je songeais à elle. Je me demandais à quoi elle pouvait bien servir si personne ne l’ouvrait, si elle allait finir par être murée, si ceux qui l’utilisaient ne venaient que très tôt ou alors très tard, à l’abri des regards de la foule laborieuse. Ces interrogations successives finissaient par nourrir une espèce de rêve confus, informulé, adossé à un bien pauvre mystère. Bien entendu, je sais très bien pourquoi je n’ai jamais osé ouvrir cette porte : j’avais peur de ce que j’allais trouver derrière elle, et par-dessus tout j’étais terrorisé à l’idée de n’y rien trouver du tout, ou alors une cour cimentée et aveugle, ou une clôture infranchissable, ou un passage étroit donnant sur une rue morne et sans vie. Je ne savais même pas si elle était verrouillée. J’ai longuement protégé le fantasme qu’elle était devenue en moi, en la maintenant en-deçà du réel, en l’empêchant de redevenir ce qu’elle n’avait jamais cessé d’être : une issue semblable à des dizaines d’autres, que l’on emprunte sans y penser, un passage de service, un truchement vers l’improbable ailleurs.
Je vais ouvrir cette porte. Il n’y a plus aucune raison d’hésiter. A présent, ils sont tous partis. L’usine a cessé d’être. Ce n’est plus qu’une longue bâtisse en déréliction, dont les machines ont été démontées et les bureaux vidés. J’ai marché tout au long de l’ancien atelier. Le bruit de mes pas sur le ciment. La chanson du vent faisant irruption par les fenêtres brisées. Le silence épais, lourd comme le souvenir. Quelques oiseaux voletant d’une poutrelle à l’autre. En vain, j’ai essayé de retrouver l’emplacement de mon ancien poste de travail, mais l’honnêteté m’oblige à écrire que je ne me suis guère attardé dans cette recherche. C’est seulement pour elle que je suis revenu, que j’ai pris le train jusqu’à la ville, que j’ai refait le chemin d’autrefois, sur le bas-côté de la route longiligne au long de laquelle je n’ai croisé personne.
Pour ouvrir cette porte.
Désormais, je suis tout proche, plus proche d’elle que je ne l’ai jamais été. Il me suffirait de tendre la main pour effleurer la poignée, sauf que la poignée a disparu. J’appuie contre le bois, légèrement, puis avec davantage de force, mais elle ne cède pas. Même de tout près, on ne voit pas grand-chose à travers la vitre ; des formes grises et indistinctes qui n’ont probablement rien à raconter. Il serait facile, même à mon âge, de donner un grand coup de pied tout près de la serrure, ou de briser le carreau. Un jour ou l’autre, quelqu’un s’en chargera, sans doute pour rien, pour s’amuser, pour avoir l’impression de tromper son ennui, ou pour se donner l’illusion d’entrer par effraction dans un bâtiment ouvert à tous les vents.
Alors je décide de ne rien faire de tout ça, de n’être pas celui qui portera le premier coup à mon propre rêve. Je ne défonce pas la serrure. Je ne casse pas la vitre. Je m’éloigne de la porte verte qui m’a si longtemps hanté. Je ne saurai pas ce qu’elle dissimulait. J’emporte avec moi un secret hypothétique impossible à briser. Il m’a fallu revenir ici pour le comprendre.
Je ne vais pas ouvrir cette porte. Il aurait fallu le faire quand je le pouvais encore, quand la poignée luisait doucement au loin, tout au bout de l’atelier, quand ma vie recelait encore des possibles, quand le fait d’espérer avait encore un sens.
A présent, il est trop tard.
Texte par Nicolas Fourny
Automne Secret
Musique par Microfilm



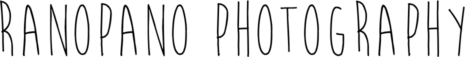

One Comment
Je vous propose en lecture complémentaire à ce texte, la bande dessin « Putain d’usine » de Jean-Pierre Levaray et Efix