The Only Moment We Where Alone (Le seul moment ou nous étions seuls)
« Et tu n’es plus jamais revenue ?
‒ Non, c’était impossible. Je ne pouvais pas. Pas après tout ce qui s’était passé, tout ce qui avait eu lieu là-bas, enfin je veux dire ici. J’ai du mal à y penser comme autrement que comme un endroit lointain, forcément lointain, parce qu’il était vital que je m’en éloigne. J’ai du mal à me dire que bientôt ce sera de nouveau ici. J’ai tellement eu hâte. Il fallait que je m’en aille, il le fallait.
‒ Mais tu reviens. Tu es ici à présent. Comme avant.
‒ Je reviens parce que je n’ai pas le choix. Tu sais, il arrive un moment dans la vie où tu comprends que tu vas tout perdre si rien ne change, si tu restes immobile, au seuil des choses, sans oser franchir les portes que d’autres ont pris le soin de verrouiller devant toi. J’ai compris cela. Je suis sorti de ma chambre, j’ai traversé le corridor, le vestibule, le parc, je me suis engagée sur la route et je savais que si je m’étais retournée, j’aurais vu pour la dernière fois la façade de la maison, avec ses volets à demi clos, l’épaisseur de son silence, ses sommeils trompeurs. C’était comme si elle avait recelé une menace assourdie, que l’on ne percevait pas tout de suite. En fait on ne peut jamais décider que ce sera la dernière fois. On ne peut jamais en être sûr…
‒ C’était quand ?
‒ En 1972. Au mois de juin. Je me souviens qu’il faisait très chaud. Je m’attendais à entendre des cris derrière moi, à ce que ma mère me rattrape et m’ordonne de revenir. Mais non. Ils ne sont pas venus, personne n’est venu. J’ai avancé sur la route dans le soleil de cinq heures, j’ai vu la lumière qui changeait et au bout d’un moment j’ai compris qu’ils ne viendraient pas, qu’ils n’allaient pas me poursuivre, qu’ils ne se souciaient plus de ma fuite.
‒ Ce n’était pas la première fois que tu essayais de partir.
‒ C’est vrai. J’ai bien dû m’enfuir à dix ou douze reprises. Une fois, je suis même arrivée jusqu’à la ville. Je cherchais la gare, je voulais monter dans le premier train que je verrais, sans me soucier de sa destination. Mais sur la place, devant la gare, il y avait la Ford noire de mon père, et lui, debout à côté d’elle, me regardant venir jusqu’à lui sans un mot, ouvrant la portière, attendant que je m’installe à l’arrière, la refermant, me ramenant à la maison.
‒ C’est ensuite qu’il t’a battue ?
‒ Je ne veux pas en parler.
‒ C’était combien de temps après que…
‒ … après que ma sœur soit partie ? Environ trois ans. Après quoi j’ai appris à haïr cette maison, chacune de ses briques, chacune de ses fenêtres, chacune de ses poignées de porte, chacune de ses pièces, chacun de ses meubles. Plus rien de ce qui la constituait ne m’était supportable. Tu comprends, j’habitais là, dans la pièce où ma sœur était morte, et ils ne voulaient pas que je change de chambre, ils m’obligeaient à y vivre, à m’y endormir chaque soir, alors qu’elle était encore tellement là. J’étais près d’elle quand c’est arrivé. J’ai très distinctement entendu la dernière fois qu’elle a expiré de l’air, c’était un bruit léger, presque imperceptible. Elle était allongée là, sous la grande fenêtre, celle qu’on ne peut pas ouvrir. Quelques jours auparavant, elle avait demandé qu’on déplace son lit jusque-là. Elle regardait dehors, enfin elle essayait. Son visage était devenu gris de fatigue, de terreur, de souffrance. Elle avait compris ce qui allait se passer.
‒ Elle en parlait ?
‒ Parfois, oui… La première fois, il y avait mon père. Il était assis au bord de son lit. Il lui tenait la main, lui murmurait des phrases automatiques sur le fait qu’il était là, qu’il allait s’occuper d’elle, qu’elle irait mieux. Elle l’a regardé et lui a dit : je sais très bien que je vais mourir. Il a lâché sa main, il est sorti de la chambre, et il n’y est pas revenu jusqu’au jour où elle a cessé de respirer, où elle s’est mise à contempler le plafond de ses grands yeux vitreux. Ce plafond que j’ai moi-même regardé, des heures durant, en essayant de dormir, en essayant surtout de ne pas penser à elle. Regarde comme il est devenu, il se désagrège, quelque chose achève de le ronger et de le détruire, comme la maison tout entière, comme la mémoire, comme le passé.
‒ Comme ta famille, aussi.
‒ Oui… la famille… quand je suis entrée dans la maison, tout à l’heure, j’ai eu l’impression de pénétrer dans une geôle désertée. Je suis là, dans ce lieu qui a été une chambre, puis une morgue, puis un débarras, puis plus rien du tout, parce que je ne peux pas faire autrement, et cependant une partie de moi-même pressent que cela devait se produire… Je ne sais pas bien l’expliquer. Ma sœur et moi, ici. Nous avons grandi ensemble, dans cette pièce, et puis elle m’y a laissée, seule, plus seule encore que je le craignais pendant sa maladie. Je regarde la fenêtre et je la revois si précisément, étendue dans le froid net qui s’emparait de son corps, avec ses mains décharnées posées sur le drap, avec ses paupières qui bleuissaient. Je lui avais fermé les yeux. Alors ils sont entrés, ma mère et mon père, ils se sont approchés du lit, ils ne me regardaient pas, ils la dévisageaient, elle. Elle qui n’était plus là. Pas moi qui étais vivante.
‒ Ont-ils pleuré ?
‒ Jamais devant moi. Je crois que, pour eux, les larmes, le chagrin, et même la plus banale des mélancolies, tout ça avait quelque chose d’obscène, ça devait rester secret. Ils n’ont rien montré ce jour-là, ni quand les types des pompes funèbres sont arrivés avec le cercueil et la plaque avec le nom de ma sœur vissée dessus, ni quand ils l’ont emportée, ni lorsqu’on l’a incinérée. Après la cérémonie, nous sommes revenus ici et ils ont recommencé à vivre comme ils le faisaient avant, comme si rien n’avait changé. Peut-être était-ce le seul moyen qu’ils avaient trouvé pour faire face, pour ne pas sombrer.
‒ Ou peut-être qu’ils étaient simplement inhumains.
‒ Je ne le crois pas. Je crois qu’à leur façon, ils nous aimaient. Ils nous aimaient d’une façon qui m’a rendu horriblement malheureuse, ils nous aimaient parfois en nous enfermant, ils nous aimaient parfois en nous frappant. Ils nous aimaient dans le silence, la tristesse et la brutalité. Ils nous ont appris la nécessaire âpreté de la solitude, à nous méfier des autres comme eux-mêmes s’en méfiaient, tous ces gens de l’ailleurs, qui vivaient en dehors de la maison, au-delà du parc, dans la ville, et qui nous voulaient du mal.
‒ Et tu l’as cru.
‒ Oui, pendant très longtemps je l’ai cru. Je faisais même plus que le croire : je le savais. Notre chambre était sûre, inlassablement sûre, aussi protectrice qu’une forteresse. Ici, rien ne pouvait nous arriver. Et puis le cancer est entré dans la maison sans que rien ne puisse l’arrêter, il est entré dans la pièce où nous avions grandi, blotties dans le mensonge qu’on avait élaboré pour nous, il est entré dans le cerveau de ma sœur et il l’a tuée. Le mensonge ne l’a pas stoppé. Au matin de sa mort j’ai regardé la lividité de son visage, l’éternelle indifférence qui s’y était installée. C’est, je crois, à ce moment-là que j’ai décidé de partir.
‒ Ils t’ont vue changer ?
‒ Ils n’ont pas compris tout de suite ce qui arrivait. Ils n’ont rien vu de ma révolte, jusqu’à ma première tentative de départ. Et quand ils ont décelé les indices de cette révolte, ils ont entrepris de m’étouffer.
‒ Tu es devenue leur prisonnière…
‒ Pas au sens littéral du terme. Je pouvais sortir de ma chambre. Je pouvais aller dans le parc. Et bien entendu j’allais à l’école, six jours par semaine. Mais c’était ma mère qui m’y emmenait et qui revenait m’y reprendre. Mon univers ne cessait de rétrécir. Mon père et ma mère se recroquevillaient sur eux-mêmes, incapables de prendre en charge leur propre chagrin, de l’affronter, de trouver la clé de l’apaisement. Et ce faisant, ils se sont aussi recroquevillés sur moi…
‒ Ils avaient peur que toi aussi tu partes. Ils avaient peur de te perdre.
‒ Ils avaient surtout peur de ce qu’ils ne pouvaient contrôler. Et donc ils ont décrété qu’aucun changement n’était acceptable. C’est pour cela que j’ai passé tant d’années ensuite, seule dans cette pièce qui exsudait la maladie, le désespoir et le malheur, sans musique, sans amis, sans tendresse, sans rien, à part les livres. C’est pour cela que je me suis détachée d’eux, qu’ils me sont devenus étrangers, l’un et l’autre. Je me souviens du regard de mon père, quand nous dînions tous les trois. Il lisait son journal posé sur la table tout en mangeant. Il ne me regardait presque jamais et, quand ses yeux croisaient les miens, ils se détournaient aussitôt, comme s’il avait vu en eux quelque chose qui l’effrayait.
‒ Comment as-tu su pour la maison ?
‒ C’est l’un de mes oncles qui m’a retrouvée. Cela lui a demandé du temps et pas mal d’efforts. Je crois qu’il a même engagé un détective… Enfin, bref, c’est lui qui m’a appris que mon père s’était pendu il y a douze ans, que ma mère s’était, peu de temps après, retirée dans un couvent de visitandines, à quelques kilomètres d’ici, et que la maison était livrée à elle-même.
‒ Apparemment, elle a surtout été livrée aux pillards.
‒ Oui. En apparence, c’est un lieu désolé et vide, mais elle n’a pas perdu la mémoire. Et moi non plus.
‒ Que comptes-tu en faire ? Elle est à toi maintenant.
‒ Je ne compte rien en faire. Je suis venue parce que mon oncle me l’a demandé, parce qu’il a été très gentil dans sa façon de m’annoncer les choses, et aussi parce que je voulais savoir ce que je ressentirais en m’approchant de nouveau de la maison, en y entrant, en revenant dans cette chambre. Je sais maintenant que je peux l’appréhender de façon clinique, factuelle, sans pathos. C’est un chapitre ancien que je n’ai pas envie de relire, mais cependant je ne puis en effacer le souvenir.
‒ Alors elle va continuer de se dégrader…
‒ Sans doute, oui… mais tu sais, il y a longtemps déjà que ce lieu a cessé de vivre. C’est comme les anciens navires que l’on désarme, ils cessent d’être des bateaux, ils ne sont plus que des coques en attendant qu’on les détruise pour de bon. Il en est ainsi de cette maison. Il en est ainsi de ma jeunesse. Viens, on s’en va. »
Texte par Nicolas Fourny
Automne Secret
Musique par Explosions In The Sky



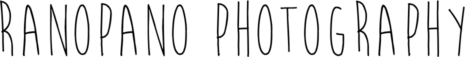


2 Comments
Thanks for your blog, nice to read. Do not stop.
Thanks Mark 🙂 You’re message illuminate my day !