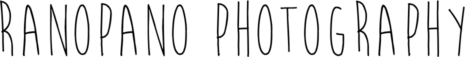Exploring Yourself With A Knife
Carrelage & poussière
L’isolement est une forme de combustion.
Et j’ai besoin de vous.
J’ai besoin de vous qui n’êtes pas là.
Je ne sais pas où vous êtes.
Ou alors j’ai oublié.
Je vous ai peut-être rêvés.
Peut-être que vous n’existez pas.
Appartenez-vous au réel ?
Et qu’est-ce que le réel ?
Je ne sais plus compter, ni les heures, ni les jours, ni rien.
Quand on m’a installé ici, on m’a expliqué que j’étais dangereux. Que je devais être isolé des autres. Ces autres dont je ne perçois les mots et les cris que confusément, de très loin, comme s’il s’agissait de phrases prononcées des années auparavant et dont l’écho refuserait de mourir. Ces autres dont je ne puis me remémorer les visages. Ces autres qui ne savent pas que je suis.
C’est une grande pièce pour un seul homme. Vraiment très grande. Il y a tout ce dont j’ai besoin. Je peux même faire de l’exercice, aller d’un mur à l’autre, sous la lumière chancelante filtrée par la saleté des vitres, là, juste au-dessus de moi. Rien ne m’entrave. On ne m’enchaîne que pour les examens médicaux. Ils ont lieu ici même, dans la pièce qui me verra mourir. Ils ne veulent pas que je sorte, même pour aller à l’infirmerie. Ils me veulent ici, sous leur contrôle.
Le premier jour, il y a mille ans, ou peut-être une semaine, j’ai rencontré le directeur. Nous étions dans son bureau, une pièce pauvrement meublée, avec une table de travail métallique aux standards de l’armée, un diplôme accroché au mur, deux armoires, un sol de béton nu, des murs lisses peints en gris clair. Lui-même semblait s’être imprégné de ce décor. Son costume ‒ flanelle anthracite ‒, ses lunettes ‒ imitation écaille ‒, sa cravate de laine ‒ de la laine tricotée, bleu marine ‒ tout répondait à l’atmosphère de ce bureau, avec une fidélité morne, mécanique, tout comme ses mots à lui étaient mécaniques, débitant les articles du règlement intérieur de l’établissement avec autant d’humanité qu’un magnétophone.
Son monologue n’a pas duré plus de trois minutes, ensuite ils m’ont emmené ici, dans le refuge blanc et démesuré où ils pensent que je dois terminer ma vie. Et si ça se trouve, ils ont raison. Je ne me souviens plus très bien de ce qui s’est passé, de ce que j’ai fait. A part la mémoire de leurs cous. Ça, je me le rappelle. Leurs cous si durs au début, je peux encore les sentir au creux de mes poings, leur sueur et ma sueur mêlées, la texture de leur peau. A quoi ressemblaient-elles ? J’avais mal, après. J’avais mal aux mains. On m’a dit qu’elles étaient mortes. Que je les avais tuées. Toutes, toutes tuées. Et que ce n’était pas ma faute, que j’étais anormal, que mon discernement avait été altéré. (Admirable monde où les actes les plus effrayants trouveront toujours une traduction technocratique pour en atténuer l’énoncé.)
Quand je marche dans cet endroit, cet endroit qui est chez moi, je repense au procès, sans doute pour tuer le temps. Je repense à plein de choses, en fait. Mon avocat s’approchant pour me dire que mon irresponsabilité avait été reconnue par les experts, que c’était une bonne nouvelle. Le témoignage du légiste. Un type chauve se précipitant vers moi en hurlant qu’il allait me tuer, avant qu’un gendarme ne le stoppe. Ma mère pleurant pendant qu’on lui crache dessus. Le crépitement des flashes. Les cris. La haine. La mort qu’on réclame en une scansion obscène.
L’isolement est une combustion et depuis lors je me consume car la solitude, c’est quelque chose qui finit par vous mordre et vous brûler. Et le silence, ce silence que je ne sais même plus rompre. Les types qui m’amènent les plateaux repas et qui les reprennent ensuite ne disent presque jamais rien. Entendre une voix humaine prononcer une phrase intelligible est devenu un espoir dépourvu de sens. Même la mienne a disparu. La seule chose que je perçois encore, chaque nuit, par-dessus le ronronnement de l’air conditionné et les vociférations lointaines, ce sont les grincements. Le genre de grincements que produisent deux objets de métal rouillé que l’on frotte l’un contre l’autre. Je ne sais pas d’où ils proviennent. Ils sont comme proches de moi, mais autour de moi, il n’y a rien, à part cette chaise inutile, les murs, les vitres et les canalisations fixées au plafond. Et pourtant ils sont là, pas très bruyants en réalité, juste assez pour m’empêcher de réellement dormir. C’est peut-être juste le bruit que produit une mémoire en train de moisir.
J’ai besoin de vous. Je me demande pourquoi personne n’est venu me tuer.
Si l’un d’entre vous, de ceux qui ne peuvent plus se permettre de dire qu’ils m’ont aimé, entrait dans cette pièce, c’est ce que je lui demanderais. Je lui demanderais de m’ôter le souffle si horriblement régulier qui est le même, qui n’a pas changé, car bien entendu l’oxygène se fout de ce que vous avez fait, des gens que vous avez assassinés et de ceux que vous avez fait souffrir, dont vous avez fracassé les existences, il continue à entrer en vous et à vous maintenir en vie et à vous permettre de comprendre à quel point votre vie n’a plus de signification.
Je respire comme avant. Souvent, j’essaie de me concentrer sur ce phénomène stupéfiant et banal qu’on nomme respiration. L’air. La respiration. L’expiration. Ce qu’on absorbe, ce qu’on rejette, avec indifférence le plus souvent. Ces choses qu’on n’a même pas besoin d’oublier, parce qu’on n’a pas conscience de les accomplir. Je suis un assassin et je ne sais pas pourquoi. Tout autour de moi, sans cesse, des clés tournent dans des serrures, des portes pivotent sur leurs charnières, des gens entrent et sortent sans doute, peut-être même qu’on les libère.
Qu’on les libère.
Quelle phrase, quand on y pense. C’est peut-être la plus belle phrase de l’univers. Au fil de mes somnolences, j’imagine souvent une voix, celle du gardien-chef, en train de prononcer ces mots à mon sujet. Qu’on le libère ! Qu’on vienne le prendre, qu’on se saisisse de lui, qu’on l’extirpe de sa cellule, qu’on le jette dehors. Comme s’il pouvait encore y avoir un dehors. Comme si je pouvais encore mériter un dehors.
Ils se sont occupés de ce que j’avais fait, mais ils ne s’occupent pas de ce que je suis. Je ne suis pas là pour être soigné. Ce n’est pas l’objet. On ne m’a pas enfermé pour que je guérisse. Ils ne doivent pas savoir comment faire. Personne, jamais, ne vient me parler, ne serait-ce que pour essayer de comprendre. Les mécanismes et les névroses qui ont fait qu’ils me considèrent comme un monstre, un type qui pourra continuer de manger, de boire, de respirer, de penser, après avoir commis plusieurs fois le pire, ça ne les intéresse pas. Seuls comptent les clôtures, les barrières, les remparts que l’on place entre la normalité et la folie, en espérant pouvoir s’en protéger. On se protège de ce qu’on ne peut contrôler par l’éloignement, par la distance, par la surveillance.
Et par l’invulnérable silence de l’oubli.
L’oubli, cette forme impersonnelle, passive, et terriblement neutre, de mort.
Texte par Nicolas Fourny
Automne Secret
Musique par April Rain